Épée (escrime)
L’épée est une des trois armes de l’escrime (avec le fleuret et le sabre). C’est une arme d’estoc. L'épée est une arme tous publics, car les actions pendant les assauts sont relativement lentes par rapport aux autres armes et parce qu’il n’y a pas de convention, ce qui permet au public de facilement suivre la phrase d’armes.

Une épée à poignée droite
Sommaire
1 Arme de l'escrime
2 Matérialisation des touches
3 Convention
4 Technique et maniement de l’épée
5 Épéistes célèbres
6 Notes et références
7 Bibliographie
Arme de l'escrime |
L’épée mesure 110 cm de long pour 770 grammes maximum. La longueur de la lame est de 90 cm. La section de la lame de l’épée est triangulaire. La partie de la lame parcourue par les fils électriques doit être sur le dessus. Ses bords ne sont pas coupants. La lame doit être la plus droite possible, une courbure est tolérée à condition qu’elle n’excède pas 1 cm[1].
La lame est parcourue (à l’intérieur d’une rainure) de deux fils électriques qui relient le bouton à deux des trois broches présentes dans la coquille. La troisième broche est reliée à la masse de l’épée. Le bouton fonctionne sur le principe d’un interrupteur. Il faut y exercer une pression supérieure à 750 grammes pour permettre le passage du courant électrique du circuit de l’épée.
La coquille de l’épée est circulaire. Elle protège la main qui porte l’épée. Son diamètre ne doit pas dépasser 13,5 cm. Elle est isolée électriquement pour ne pas être comptabilisée comme une surface valable.
Le tireur tient son arme par la poignée. Celle-ci peut être de plusieurs types : droite, orthopédique (aussi appelée poignée crosse car plus maniable, type italienne, française, hongroise, …)
Matérialisation des touches |
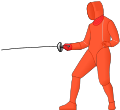
En rouge, aire de touche à l'épée
La surface valable correspond à la totalité du corps du tireur. Le tireur ne porte pas, à la différence du fleuret et du sabre, d’équipement conducteur. Il tire sur une piste métallique qui l’isole du sol afin de permettre la matérialisation électrique de la touche uniquement sur son corps.
Il est à préciser quand même qu'une touche portée sur n'importe quelle partie de l'épée du tireur qui n'est pas isolé (comme des traces de colle ou encore des taches formées d'oxyde) est considérée comme valable et ne peut pas motiver l'annulation de la touche ainsi portée[2].
Convention |
La convention de l’épée a été adoptée à Paris en juin 1914 par la commission d’épée de la Fédération Internationale d’Escrime. Elle reprend, précise et complète les règlements élaborés par les diverses commissions et académies depuis 1882.
Les règles régissant les épreuves d’épées tirées à l’appareil de contrôle électrique des touches ont été rajoutées en 1936.
La convention de l’épée déclare que le premier des deux tireurs qui touche l’autre emporte le point. Si les deux tireurs se touchent simultanément (on parle alors de coup double), les deux tireurs marquent un point.
Technique et maniement de l’épée |

Finale de l’édition 2012 du Challenge Monal (tournoi de coupe du monde d’épée à Paris), opposant Diego Confalonieri (à gauche) à Fabian Kauter (à droite). Kauter touche en attaquant en flèche alors que Confalonieri touche en contre-attaque (arrêt).
Contrairement aux deux autres armes que sont le fleuret et le sabre, l’épée n’est pas régie par les conventions de priorité, le premier qui touche marque le point.
À l’épée, la conversation est libre. Il s'agit donc non pas de jouer uniquement sur la souplesse et la technique (comme au fleuret) ou sur la vitesse et l'explosion (comme au sabre), mais d'allier ces différents facteurs au sein d'une stratégie mouvante et vivante qui permettra de prendre le tireur adverse au piège. L’épée est avant tout l’arme de l’attente, de l’observation, de la préparation. Quand la faille adverse est enfin découverte et percée à jour, il s’agit de s’y engouffrer avec force, rapidité et finesse.
On observe généralement deux types d’épéistes : le premier, opportuniste, attend l’erreur de son adversaire pour ensuite fondre sur lui quand l’occasion espérée se présente ; l’autre, bretteur, provoque l’erreur de son adversaire en l’attaquant de front. Ces deux attitudes varient souvent au gré et en cours de combat, selon la personnalité du tireur adverse, l’ambiance du moment, l’état de corps et d’esprit de l’escrimeur à cet instant.
Épéistes célèbres |
- Edoardo Mangiarotti
- Pavel Kolobkov
- Laura Flessel
- Timea Nagy
David Maillard (handisport)- Auriane Mallo
Notes et références |
FIE, « Règlements : le contrôle des armes et du matériel » [PDF], sur http://fie.org/fr, décembre 2013(consulté le 25 décembre 2015), p. 5
« Règlement technique », sur escrimeenligne.free.fr, édition novembre 2002, modifié décembre 2003 (consulté le 19 janvier 2016)
Bibliographie |
Pascal Brioist, Hervé Drévillon et Pierre Serna, Croiser le fer : Violence et culture de l'épée dans la France moderne (XVIe–XVIIIe siècle), Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2002.(Pascal Brioist est maître de conférences à l’université de Tours. Hervé Drévillon et Pierre Serna sont maîtres de conférences à l’université de Paris 1.)
- Portail de l’escrime